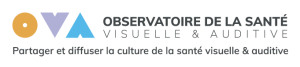
Le cytomégalovirus : attention aux séquelles auditives
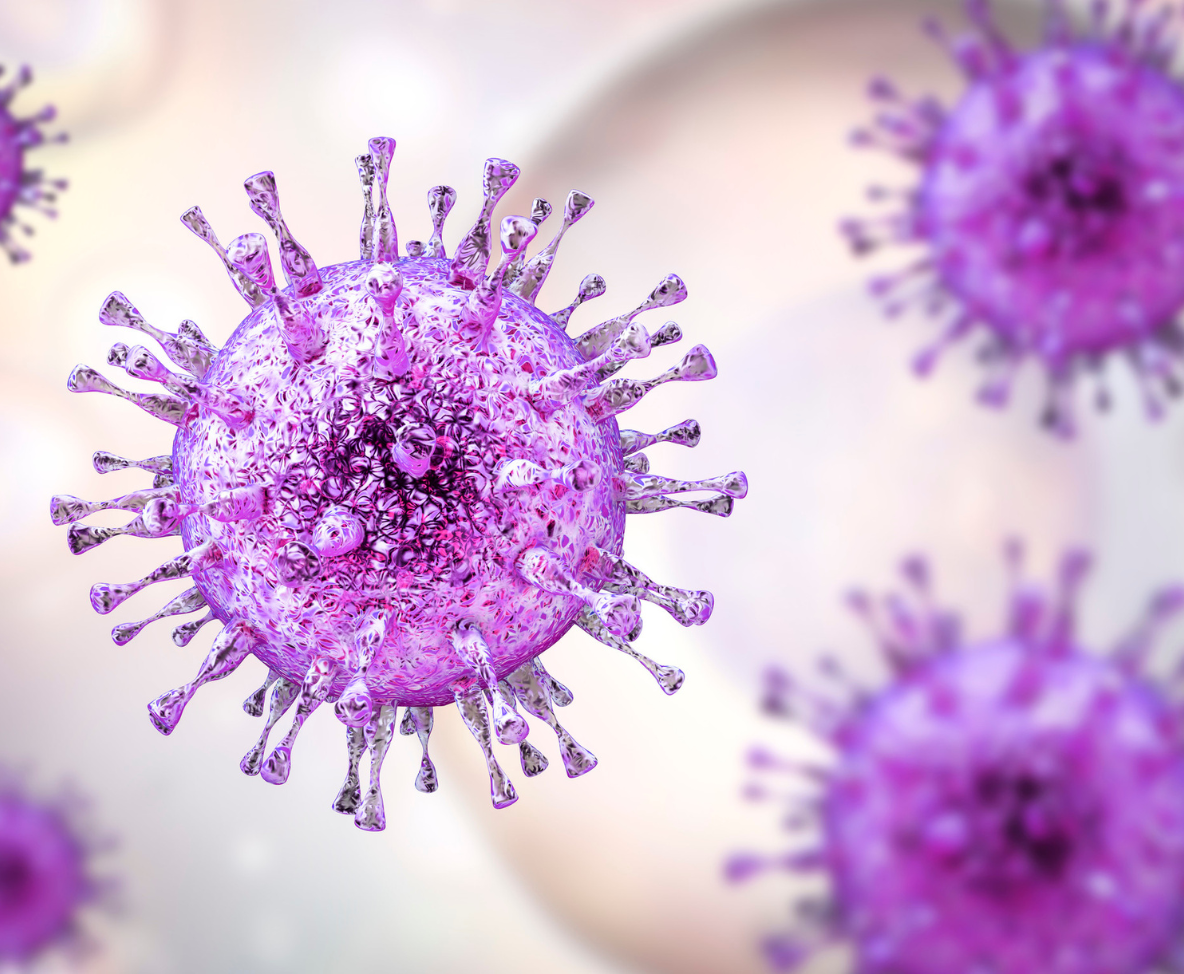
C’est un virus dont on entend rarement parler. Or, beaucoup plus de nouveau-nés sont infectés par le cytomégalovirus (CMV) que par la toxoplasmose ou la rubéole. C’est l’infection la plus fréquente pendant la grossesse, et la première cause de surdité non génétique chez l’enfant. Les explications du Pr Olivier Picone, gynécologue-obstétricien dans l’Unité de diagnostic prénatal de l’hôpital Louis Mourier à Colombes.
Qu’est-ce que le cytomégalovirus ?
Pr Olivier Picone : « C’est un virus très fréquent, qui appartient à la famille des Herpèsvirus, qui compte dans ses rangs notamment le bouton de fièvre, l’herpès génital ou la varicelle. Il a une particularité : une fois qu’une personne l’a contracté, il reste dormant dans l’organisme toute la vie. Comme les autres Herpèsvirus, il peut, parfois, se réactiver. À l’image du zona, qui est une réactivation de la varicelle. Aujourd’hui, on ne sait pas très bien expliquer pourquoi le virus va se réactiver. Le plus souvent, une infection n’aura aucune conséquence, et passera inaperçue. Cependant, ce virus peut être à l’origine de complications graves pendant la grossesse, pour le fœtus ».
Quelles sont les séquelles possibles chez les nouveau-nés ?
Pr Olivier Picone : « Le spectre de la maladie est extrêmement large. La gravité des séquelles est très variable. Dans la majorité des cas, le fœtus n’a pas de séquelles de cette infection. Mais de temps en temps, il peut y avoir des troubles de l’audition, et dans les formes graves, un déficit intellectuel et moteur. Il s’agit d’une surdité neurosensorielle, souvent sévère, et bilatérale. La majorité de ces enfants sourds souffrent aussi de troubles vestibulaires. Quand l’équilibre est aussi atteint, l’enfant peut présenter un retard à la marche ou une instabilité ».
Comment se transmet-il ?
Pr Olivier Picone : « Par contact avec des sécrétions corporelles contenant du virus (urine, salive, larmes…). La contamination est très fréquente chez les tout petits qui fréquentent une collectivité. Des études estiment qu’entre 20 à 60% des enfants en crèche excrètent du virus, sans présenter de symptôme. C’est pourquoi les parents qui ont un enfant en crèche risquent plus que les autres d’être contaminés. Dans la majorité des cas, la personne atteinte, adulte, sera asymptomatique. Parfois, l’infection au cytomégalovirus peut se manifester par un syndrome grippal : fièvre, grosse fatigue, maux de tête, douleurs musculaires… Elle guérira alors spontanément. »
Existe-t-il des moyens de prévention qui peuvent empêcher une future maman d’être infectée par ce virus pendant la grossesse ?
Pr Olivier Picone : « Oui, tout à fait. Des mesures d’hygiène simples sont efficaces pour diminuer le risque de contamination : se laver les mains fréquemment pour éliminer le virus, en particulier en moment des changes, ne pas embrasser un enfant sur la bouche, éviter de manger avec les mêmes couverts ou de boire avec le même verre que l’enfant, éviter de prendre un bain avec ce dernier (risque de contamination par l’urine)… Ces mesures doivent être appliquées non seulement par la future maman, mais aussi par le conjoint. Elles diminuent fortement le risque. »
Quel est le risque qu’une femme enceinte contamine son bébé ?
Pr Olivier Picone : « En France, 50% des femmes en âge de procréer ont déjà rencontré le virus. Le taux de transmission est plus faible au début qu’à la fin de la grossesse. Mais le risque de séquelles est inversement proportionnel. Autrement dit, les formes sont plus graves au début de la grossesse, lors du premier trimestre, car cela coïncide avec une période de développement très intense pour l’embryon. En France, les études estiment qu’entre 0,3% et 0,6% des enfants naissent infectés. Environ 20% de ces enfants infectés développeront des séquelles. »
De nombreuses femmes enceintes passent à travers les mailles du dépistage, ce dernier n’étant pas généralisé ?
Pr Olivier Picone : « En effet, il n’y a pas de recommandations nationales. Ce virus souffre d’une méconnaissance à la fois du grand public et des soignants. Le sujet du dépistage fait débat. L’Académie de médecine y est favorable. Le Haut conseil pour la santé publique y est opposé. À titre personnel, j’y suis favorable, car nous avons aujourd’hui les moyens de poser un diagnostic fiable, et de diminuer le risque de transmission du virus de la mère au fœtus. Aujourd’hui, certaines maternités font ce dépistage, d’autres non. Les femmes enceintes peuvent le demander au médecin ou à la sage-femme qui les suit. »
Que se passe-t-il quand une femme enceinte s’aperçoit lors du dépistage qu’elle est infectée ?
Pr Olivier Picone : « Si on fait le dépistage en tout début de grossesse, et qu’on s’aperçoit qu’il y a une infection, on peut diminuer le passage de ce virus de la maman vers le fœtus. Le valaciclovir diminue des deux tiers le taux de transmission de la mère à l’enfant. Encore faut-il que le traitement soit donné le plus tôt possible après l’infection. Ce traitement antiviral consiste à prendre quatre comprimés quatre fois par jour. L’état de santé du fœtus sera suivi par des échographies régulières, éventuellement une amniocentèse, et une IRM. Quand les séquelles suspectées sont sévères, une interruption médicale de grossesse peut être discutée. »
Quels sont les traitements aujourd’hui disponibles pour les enfants concernés ?
Pr Olivier Picone : « Des études ont montré l’intérêt d’un traitement viral chez les nouveau-nés symptomatiques, pour diminuer la sévérité des atteintes auditives. Pour soigner une perte d’acuité auditive, un appareil auditif ou un implant cochléaire sera proposé. Un suivi avec un ORL et un orthophoniste sera aussi nécessaire. Les séquelles auditives pouvant parfois apparaître quelques mois ou quelques années après la naissance, un enfant infecté par le CMV devra bénéficier d’une surveillance audiométrique régulière, jusqu’à l’âge de 5-6 ans, pour rechercher une éventuelle dégradation auditive. Si besoin, une rééducation vestibulaire pourra permettre « d’améliorer les troubles de l’équilibre. Pour les troubles neurologiques, malheureusement, il n’existe pas à l’heure actuelle de traitement miracle. Un vaccin est à l’essai, mais il est encore loin d’être prêt. »
