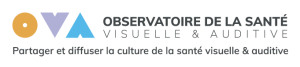
Des rétines artificielles à la thérapie sonogénétique, les pistes des chercheurs pour redonner la vue aux aveugles

Restaurer la vue -partiellement- grâce à un implant, ou une rétine artificielle, sera-t-il bientôt possible ? Oui, répondent les nombreux chercheurs qui travaillent sur ce sujet enthousiasmant. Les explications de Serge Picaud, directeur de recherche Inserm, et directeur de l’Institut de la vision.
Les pouvoirs de l’œil sont extraordinaires. Mais cet organe précieux est aussi fragile. L’un de ses talons d’Achille, ce sont ses photorécepteurs. Des millions d’entre eux se trouvent au fond de l’œil, dans la rétine. Ils travaillent jour et nuit à transformer la lumière en influx nerveux. C’est ensuite le nerf optique, sorte de « câble », qui va transporter ces messages de l’arrière de l’œil vers le cerveau. Ce dernier va alors reconstituer l’image. Dans certaines pathologies, comme la rétinopathie pigmentaire, ou la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), les photorécepteurs se dégradent et disparaissent. Cela peut entraîner une baisse de l’acuité visuelle, voire, dans les cas les plus graves, la cécité. D’où l’idée des chercheurs de « remplacer » ces photorécepteurs défaillants avec une prothèse ou une rétine artificielle.
Des électrodes pour stimuler électriquement la rétine
C’est ainsi que la rétine artificielle voit le jour. En 2012, le grand public découvre une première version, à l’efficacité limitée. Ce qui relevait jusqu’alors de la science-fiction a pour nom Argus II. Conçue par la société américaine Second Sight, cette prothèse est implantée à plus de 300 patients atteints de rétinopathie pigmentaire à travers le monde. Elle contourne les cellules rétiniennes mortes, et stimule électriquement les cellules résiduelles connectées au cerveau, pour induire une perception visuelle. L’implant est accompagné d’une paire de lunettes, avec une caméra intégrée. Les informations visuelles capturées par cette dernière sont converties en pulsations électriques, transmises par ondes radio à l’implant. « Composé de 64 électrodes, cet implant est dit « épirétinien », c’est-à-dire qu’il est appliqué à la surface de la rétine », rappelle Serge Picaud. 64 électrodes, c’est trop peu pour réussir à voir de belles images. Mais assez pour permettre aux patients de distinguer grossièrement des formes. « Un millier d’électrodes sont nécessaires pour avoir une résolution suffisante pour lire ou commencer à reconnaître des visages. » Au fil des ans, les rétines artificielles ne cessent d’améliorer leurs performances à ce niveau. Autre changement, « les prothèses sont aujourd’hui placées sous la rétine. La plaque d’électrodes vient prendre la place des cellules photoréceptrices abîmées. » Dans tous les cas, une intervention chirurgicale est nécessaire pour la mise en place de l’implant au contact de la rétine.
Il faut sauver l’implant Prima
Un des implants de cette nouvelle génération vient de franchir avec succès toute une série de tests. Nommé Prima, il a d’abord été développé par la société Pixium vision. « Cette entreprise a fait faillite. Elle a été rachetée par la start-up américaine Science corporation. Cela permet d’espérer que cet implant sera un jour commercialisé. » En attendant, « l’essai de phase 3 vient de se terminer, avec des résultats prometteurs. Les patients qui y ont participé ont récupéré pratiquement 1/20e d’acuité visuelle. » En quoi consiste cet implant ? « Ses 378 électrodes sont positionnées sur une minuscule plaque de silicium, de 2mm sur 2mm, insérée chirurgicalement sous la rétine et sensible à la lumière infrarouge », répond Serge Picaud. « Le patient porte des lunettes équipées d’une caméra. Celle-ci capte les images, et les convertit en lumière infrarouge projetée sur la rétine. Cet implant est destiné, dans un premier temps, aux personnes atteintes de DMLA. Je milite pour que les patients souffrant d’une rétinopathie pigmentaire puissent aussi en bénéficier. Il faudrait alors faire des essais cliniques dédiés pour confirmer la faisabilité de cette approche. »
Les limites de la rétine artificielle
Aussi formidable soit elle, la rétine artificielle n’est -malheureusement- pas une baguette magique permettant de régler tous les problèmes de cécité ou de malvoyance. Elle nécessite en effet que le nerf optique soit intact. Elle ne peut donc pas fonctionner pour des pathologies comme le glaucome, la rétinopathie diabétique ou l’atrophie optique. Leur point commun ? Elles endommagent le nerf optique. « En cas de perte du nerf optique, il faut pouvoir contourner les yeux, pour stimuler directement les aires visuelles supérieures », explique Serge Picaud. « Autrement dit, mettre des électrodes directement dans le cortex visuel. » Une telle approche a été tentée ces dernières années par un chercheur espagnol, le Pr Eduardo Fernández Jover*. « Il a obtenu de bons résultats. Le patient aveugle qui a expérimenté l’implant a réussi à nouveau à lire des lettres et détecter des formes. » Là encore, le patient portait des lunettes disposant d’une caméra. Mais les images obtenues, converties en signaux électriques, étaient cette fois transmises à l’implant placé dans le cerveau. Le système doit maintenant être testé sur un plus grand nombre de patients. « Mais il a lui aussi ses limites. Pour l’instant, la prothèse rigide crée une fibrose réactionnelle – développement de tissu conjonctif fibreux -, limitant son utilité sur le long terme. »
L’alliance de la génétique et des ultrasons, une piste à explorer
L’équipe dirigée par les chercheurs Inserm Serge Picaud et Mickael Tanter, associant le laboratoire Physique pour la médecine, et l’Institut de la vision à Paris, a proposé une alternative, la thérapie sonogénétique. « Celle-ci consiste à modifier génétiquement certains neurones pour les rendre sensibles aux ultrasons. Mais comment « voir » sans nerf optique fonctionnel ? C’est là que l’innovation prend tout son sens : une caméra externe capte les images de l’environnement. Ces images sont ensuite traduites en signaux ultrasonores ciblés, émis à travers le crâne vers les neurones modifiés. Les ultrasons, capables de traverser les tissus avec précision, activent alors directement les zones du cerveau impliquées dans la vision, contournant ainsi le nerf optique lésé. « Nous avons apporté la preuve de concept de cette thérapie chez l’animal, en montrant qu’il était possible d’activer avec précision des groupes très localisés de neurones, et de le faire en temps réel, à la milliseconde près. » L’objectif de cette thérapie, à terme, est de redonner la vue aux patients avec un nerf optique endommagé. Si toutes les étapes validant l’efficacité et la sécurité de l’approche étaient franchies avec succès, ces hommes et ces femmes pourraient à nouveau reconnaître des visages, lire, ou se déplacer en parfaite autonomie.
