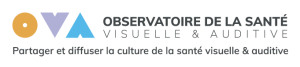
DMLA, sur la piste d’un traitement moins invasif

Aujourd’hui, le traitement de référence pour la DMLA consiste à injecter un produit directement dans l’œil. Mais les indications sont limitées et le geste reste plutôt invasif. Cependant, les choses changent, pour le meilleur. Les explications du Pr Francine Behar-Cohen, ophtalmologiste à l’hôpital Cochin, à Paris, chercheuse à l’Inserm.
Les injections d’anticorps anti-VEGF (vascular endothelial growth factor, ou facteurs de croissance de l’endothélium vasculaire) ont marqué un tournant dans la prise en charge de la forme humide de la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge).
Pourquoi avoir eu envie de proposer autre chose, jusqu’à créer une start-up dans cette optique ?
Pr Francine Behar-Cohen : La DMLA correspond à une dégradation progressive d’une partie centrale de la rétine appelée la macula, pouvant mener à la perte de la vision centrale. Sa fréquence augmente avec l’âge : elle touche 1 % des personnes de 50 à 55 ans, environ 10 % des 65-75 ans, et de 25 à 30 % des plus de 75 ans. On distingue deux formes principales : la forme sèche et la forme humide. La DMLA sèche résulte d’un amincissement anormal de la macula à mesure que les cellules visuelles, notamment les cônes et les bâtonnets, disparaissent. La forme humide, elle, est caractérisée par la prolifération de nombreux vaisseaux sanguins anormaux autour et en arrière de la macula, ce qui entraîne des fuites de sang ou de liquide et une atteinte rapide de la vision.
Aujourd’hui, les injections intravitréennes d’anti-VEGF — c’est-à-dire des injections directement dans la cavité vitréenne, à l’arrière du cristallin — permettent de traiter la forme humide. À court terme, elles sont efficaces pour bloquer le développement de ces néovaisseaux au centre de la rétine. Elles stabilisent, voire atténuent les symptômes de la maladie. Mais ces injections doivent être répétées toutes les 4 à 12 semaines. C’est un fonctionnement chronophage et contraignant. Deux jours avant l’injection, la personne est souvent stressée ; et pendant les deux jours suivants, elle ne se sent généralement pas très bien, à cause des effets secondaires. Cela entraîne un risque élevé de non-observance thérapeutique, et donc une perte d’efficacité. À long terme, en raison de phénomènes comme la fibrose sous-rétinienne ou l’atrophie maculaire, de nombreux patients finissent malheureusement par perdre leur vision.
En tant que chercheuse, je suis depuis longtemps en quête de moyens permettant de délivrer des médicaments dans l’œil de manière plus efficace, moins invasive et avec une plus grande durabilité. C’est ce qui m’a conduite à créer la start-up PulseSight Therapeutics (anciennement Eyevensys). Notre mission : développer des solutions thérapeutiques innovantes pour les patients atteints de pathologies oculaires pouvant mener à la cécité. Nous nous concentrons en particulier sur la DMLA, dans ses deux formes, sèche et humide.
En quoi consiste la technologie que vous avez développée ?

Crédit photo : Imaios
Pr F. B.-C. : Nous utilisons des plasmides, qui sont de petites molécules d’ADN servant à transporter des gènes thérapeutiques. Une fois introduits dans les cellules de la rétine, ces gènes s’expriment et produisent l’effet recherché.L’administration est mini invasive. Elle ne dure que quelques minutes en tout, sous anesthésie locale. Des micro-aiguilles réalisent d’infimes injections à la surface de l’œil, pour introduire le plasmide dans un muscle oculaire appartenant au corps ciliaire, le muscle ciliaire, qui sert ici de réservoir. La perméabilité du muscle ciliaire est augmentée à l’aide d’un léger courant électrique. Le plasmide, introduit dans les cellules musculaires par le courant, utilise la machinerie cellulaire pour produire et sécréter la protéine médicament, qui « voyage » ensuite du muscle ciliaire jusqu’à sa destination finale, la rétine. Il transforme les cellules en « usines » à fabriquer la protéine-médicament. Autrement dit, l’œil génère lui-même ses propres protéines thérapeutiques. L’efficacité est durable, de l’ordre de 9 à 12 mois. Notre programme PST-611 cible la forme sèche de la DMLA. Il repose sur un plasmide qui exprime la transferrine. Cette protéine est impliquée dans les niveaux de fer dans les yeux. Si le fer est absolument nécessaire, son excès peut entraîner un stress oxydatif, ce qui est très toxique pour la rétine et peut entraîner une DMLA, mais aussi une rétinite pigmentaire, ou un glaucome. Les études pré-cliniques ont montré que la transferrine avait le pouvoir de neutraliser ce fer en excès, réduisant ainsi le stress oxydatif et préservant l’intégrité de la rétine.
D’autres chercheurs explorent actuellement des thérapies basées sur l’utilisation de virus pour traiter la DMLA. Vous avez opté pour une thérapie sans virus. Qu’est-ce que cela change ?
Pr F. B.-C. : Notre thérapie est beaucoup moins invasive que celle impliquant des virus. Introduire un virus, ce n’est pas anodin. Cela demande une opération, pour décoller la rétine. Il peut y avoir des effets secondaires à long terme. En plus, une fois que le virus est introduit dans l’organisme, on ne peut plus le retirer. C’est une bonne chose face à des maladies génétiques, mais ce n’est pas idéal pour d’autres pathologies, celles qui sont multifactorielles, et pour lesquelles plusieurs protéines médicaments peuvent être requises en fonction du stade de la maladie.
Une des forces de votre thérapie, c’est que vous pouvez changer de médicament, en fonction de l’évolution de la maladie ?
Pr F. B.-C. : Tout à fait. Ce qu’il est important de comprendre, c’est qu’un patient peut souffrir d’abord d’une DMLA humide, puis développer la forme sèche. C’est d’ailleurs ce qui arrive dans la plupart des cas, quand les patients sont traités avec des injections anti-VEGF. L’œdème maculaire est bien réduit, mais avec le temps, cela aboutit à une forme sèche avec une atrophie géographique, qui conduit à la perte de la vision centrale. Aujourd’hui, il existe deux médicaments pour traiter cette forme sèche. Ils permettent d’éviter que l’acuité visuelle des patients ne continue à se dégrader. S’ils sont autorisés aux Etats-Unis ou dans d’autres pays, ils ne le sont pas en France. Notre thérapie permet de traiter à la fois la forme sèche et la forme humide, en changeant de molécule en fonction du stade de sa DMLA.
Où en êtes-vous de ce projet, et quelles étapes restent encore à franchir avant une éventuelle commercialisation ?
Pr F. B.-C. : Nos deux programmes, sur la DMLA sèche et la DMLA humide, ont passé le test des études pré-cliniques, qui ont démontré leur efficacité et leur sécurité. Nos essais cliniques devraient démarrer très prochainement. Nous attendons le dernier feu vert de la commission d’éthique, cela devrait se faire avant l’été. La phase 2 devrait se terminer d’ici deux ans. En parallèle, nous avons d’autres projets. Dans le programme PST 809, nous ciblons la forme humide de la DMLA. Dans cette optique, nous utilisons un plasmide capable d’exprimer deux protéines différentes : l’aflibercept, une puissante anti-VEGF, associée à une autre protéine qui lutte contre la fibrose sous-rétinienne. Là encore, des études pré-cliniques ont démontré l’efficacité de cette approche.
