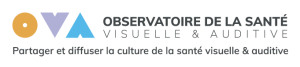
Entendre grâce à la lumière

Les implants cochléaires seront-ils bientôt concurrencés, voire dépassés, par des implants cérébraux ? C’est le souhait de scientifiques européens. Le nom de ce projet ? HearLight. Son coordinateur, Brice Bathellier, Directeur de recherche au CNRS, fait le point sur le sujet.
Restaurer l’audition d’une manière plus efficace que ce qui est aujourd’hui proposé aux malentendants, tel est l’objectif de cet ambitieux projet européen, dont les premiers résultats sont très prometteurs. Les implants testés par six équipes de chercheurs européens sont électriques et optogénétiques (c’est-à-dire qu’ils utilisent la lumière pour stimuler les neurones du cortex auditif). « Notre objectif est clair : obtenir de meilleures performances qu’avec l’implant cochléaire », annonce Brice Bathellier. « Nous aimerions aussi résoudre deux de ses limites. » Car si les implants cochléaires ont changé la vie des personnes sourdes, en leur permettant de réentendre, ils ne sont pas parfaits. « D’une part, ils ne peuvent pas être utilisés chez les patients ayant perdu leur nerf auditif. » Pourquoi ? Parce que les sons sont convertis en signaux électriques au niveau de l’oreille interne, puis acheminés via le nerf auditif jusqu’au cerveau. Quand le patient n’a plus de nerf auditif, l’oreille est déconnectée du cerveau. « D’autre part, les implants cochléaires ne contiennent que 10-12 électrodes. Résultat, la quantité d’informations arrivant au cerveau est moindre. » Impossible dès lors de restituer toute la diversité des fréquences contenues dans les sons du quotidien. La précision baisse encore lorsque beaucoup de sons se mélangent. « C’est un problème pour l’écoute des sons complexes, comme la musique, et l’écoute dans le bruit. » Ce qui est le cas, par exemple, lors d’une conversation dans un restaurant animé.
Un implant au cœur du cerveau
Au dernier étage du système auditif, le cortex auditif – la zone qui reçoit et analyse les sons – a un atout indéniable : il est plutôt grand. Un implant positionné à cet endroit bénéficierait d’une surface bien plus étendue que quand il se trouve dans l’oreille interne. C’est loin d’être anodin, car cela pourrait permettre d’utiliser beaucoup plus d’électrodes qu’avec un implant cochléaire, pour améliorer l’écoute dans le bruit et l’écoute de sons complexes. Autrement dit, cela devrait permettre de passer plus d’informations au cerveau et d’être plus précis dans la reconstitution auditive. Et ainsi, recréer un environnement sonore plus riche, plus fidèle à ce qui est perçu par les personnes normo-entendantes. « La taille de cet espace permettrait de poser un implant avec plusieurs centaines, voire milliers d’électrodes. » Cet implant pourrait permettre de contourner une autre limite des implants cochléaires. En effet, en étant implanté directement sur le cortex auditif, il pourrait être bénéfique pour les patients ayant perdu leur nerf auditif. « Nous étudions la faisabilité de ce type d’approche, chez un modèle animal. » Commencé en 2021, ce travail pré-clinique a montré des résultats très prometteurs. « Nous avons établi plusieurs preuves de concept. Dans un premier temps, à la question Quand on stimule le cortex auditif avec un certain nombre d’électrodes, est-ce que l’animal perçoit des sons ?, la réponse est oui. »
Optogénétique ou électrique, le match
« La stimulation électrique est beaucoup plus standard. Certains patients portent déjà ce type d’implants, notamment pour le traitement de la maladie de Parkinson. » La stimulation optogénétique – qui donne d’ailleurs son nom au projet, HearLight – est une autre possibilité. L’idée ? Rendre les neurones sensibles à la lumière (photosensibles) grâce à une protéine, la channelrhodopsine, issue d’une algue venant de la mer. L’intérêt ? On sait aujourd’hui quels neurones s’activent pour différents types de sons. Par exemple, les sons graves n’activent pas les mêmes zones du cortex auditif que les sons aigus. Les chercheurs veulent associer chaque son à un motif lumineux. Convertir chaque son du quotidien en un code lumineux unique est un travail titanesque, qui sera réalisé grâce à l’intelligence artificielle. « L’algorithme est capable de générer des millions et des millions de motifs lumineux, qui vont correspondre aux millions et aux millions de sons que le patient va rencontrer dans sa vie quotidienne. » Cela permettrait de recréer un environnement auditif riche et subtil. Une fois les cellules rendues photosensibles, la lumière serait utilisée pour stimuler des petits groupes de neurones du cortex auditif. Cette activation déclencherait alors une perception sonore. Electrique ou optogénétique, nous nous sommes aperçus que les deux types de stimulation fonctionnaient. Le travail pré-clinique est désormais terminé. Prochaine étape : les essais cliniques avant, si tout se passe bien, une commercialisation. « Si, comme nous le pensons, la perception sonore est effectivement meilleure, cet implant pourrait être proposé comme alternative à l’implant cochléaire. » Mais la recherche demandant naturellement beaucoup de temps, il faudra patienter encore au moins dix ans avant d’en arriver là. En France, 4% des adultes sont touchés par une déficience auditive invalidante* (c’est-à-dire une perte auditive supérieure à 35 dB dans la meilleure oreille). Si des thérapies géniques très prometteuses sont à l’étude, l’arrivée d’une nouvelle génération d’implants, plus efficaces, pour rétablir une audition au plus près de la « normale », serait aussi une formidable nouvelle pour nombre de ces patients, qui pourraient à nouveau saisir toute la beauté et la poésie d’un morceau de musique classique ou de rock, ou profiter pleinement d’un dîner entre amis dans un restaurant. Et au final, améliorer grandement leur qualité de vie. Affaire à suivre…
*selon une étude de l’Inserm et d’Université Paris Cité, en collaboration avec l’AP-HP et l’hôpital Foch à Suresnes (2022)
