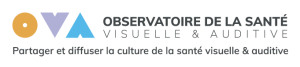
L’Institut de l’Audition sur tous les fronts pour notre audition

La Fondation d’entreprise Optic 2000 – Lissac – Audio 2000 est partenaire, depuis 2022, de l’Institut de l’Audition, centre de recherche de l’Institut Pasteur. À ce titre, elle apporte son soutien aux travaux du Centre de Recherche et d’Innovation en Audiologie Humaine (CeRIAH). Les audiologistes, ingénieurs, cliniciens et chercheurs qui y travaillent poursuivent les objectifs suivants: approfondir la compréhension des différents types de surdités, développer des outils de diagnostic innovants, ou encore imaginer de nouveaux traitements. Les explications du Pr Paul Avan, Directeur du CeRIAH.
Quelle est la raison d’être du CeRIAH ?
Pr Paul Avan : Notre objectif est de proposer des traitements plus personnalisés aux patients, en fonction de leur type de surdité, du niveau de gravité aussi. Pour bien traiter, il faut d’abord faire un diagnostic le plus précis possible. Actuellement, les tests n’apportent pas ce degré de finesse dans le diagnostic. Nous avons donc pour ambition d’arriver à diagnostiquer bien plus précisément les différents types de surdités.
Pour ce faire, nous réalisons des recherches sur des personnes volontaires, dans le cadre de l’audiologie. Nous les recrutons par le biais d’audioprothésistes ou de médecins, ORL ou généralistes. Nous étudions tout ce qui a trait à l’oreille interne : l’audition, mais aussi l’équilibre. Nous nous intéressons aussi bien aux personnes qui entendent parfaitement bien qu’à celles qui sont porteuses de tous types de surdités. Les volontaires passent de nombreux tests, certains standards, d’autres plus innovants. Les salles de tests comprennent ainsi des audiomètres, des appareils pour tester la fonction vestibulaire… que l’on trouve chez des audioprothésistes ou ORL, mais que nous avons désossés pour leur faire faire des choses complètement différentes de leur conception initiale. Cela nous permet d’avoir une idée précise de la normalité, et des différents types d’atteintes. C’est essentiel car en parallèle des progrès qui ont été réalisés sur les appareils auditifs, nous avons besoin de classifier les surdités de manière beaucoup plus précise. Pour bien traiter, un objectif clé de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) reConnect auquel le CeRIAH apporte son concours, il faudra d’abord faire un diagnostic le plus précis possible.
Parmi vos protocoles de recherche en cours, vous en avez un sur le vieillissement auditif prématuré…
Pr P. A. : Tout à fait. Certaines personnes commencent à constater que leur audition se détériore dès l’âge de 40 ans, alors qu’habituellement, ce phénomène physiologique naturel, de vieillissement de l’oreille interne démarre plutôt dans la tranche d’âge 60-70 ans. Parmi les personnes qui souffrent de presbyacousie précoce, le responsable est parfois un gène défectueux. Grâce aux thérapies géniques qui se développent, nous pourrions imaginer réparer ce gène. Des travaux de l’Institut de l’Audition ont déjà identifié des gènes qui contribuent à l’accélération de la presbyacousie normale.
Les chercheurs du CeRIAH consacrent beaucoup d’efforts pour développer de nouveaux diagnostics. Comment expliquer cet engagement ?
Pr P. A. : Il faut déjà savoir que les structures de l’oreille interne qui vont mal fonctionner ne sont pas les mêmes d’une personne à l’autre. C’est un dispositif qui comporte notamment des cellules de soutien qui jouent un rôle dans les vibrations, des cellules dont le métabolisme permet le fonctionnement électrique de l’organe… Ce système est à l’image d’un moteur de Ferrari : extrêmement complexe, avec un assemblage de nombreuses « pièces » très performantes. La moindre panne de l’une de ces pièces peut impacter le tout. Pour poser son diagnostic, le médecin ORL procède de la même manière qu’un garagiste : il doit détecter la pièce à l’origine de la panne. Il y a encore quelques années, cela ne servait à rien de savoir d’où venait la panne, car on ne pouvait pas la réparer. Aujourd’hui, ce n’est plus vrai ! Mais à la différence d’une voiture, qui peut être réparée même si elle est en panne depuis 40 ans, avec l’oreille, il faut s’y prendre très tôt. D’où l’importance d’un dépistage précoce. C’est pourquoi nous tentons de développer de nouveaux tests de l’audition.
Quelle sera la différence avec les tests existants ?
Pr P. A. : Nous souhaitons développer des tests plus simples à réaliser, avec des appareils qui prendraient moins de place que ceux que nous utilisons aujourd’hui. Ils pourraient ainsi être utilisés par des médecins non ORL. L’intérêt est évident : certaines maladies, comme le diabète, comportent une perte auditive. On recommande alors à nos collègues médecins de réaliser un audiogramme, mais ils ne sont malheureusement pas équipés pour. Nous espérons aussi que les particuliers eux-mêmes pourront se tester. Par exemple, à la sortie d’un concert. À condition bien sûr qu’ils se soucient de leur audition, ce qui n’est pas souvent le cas, je le déplore. Je pose souvent la question Combien d’examens auditifs avez-vous réalisé depuis votre enfance ?, et la plupart du temps, la réponse est Zéro. Nous n’en sommes qu’au démarrage du projet, mais nous espérons obtenir des résultats dans les cinq prochaines années.
La Fondation d’entreprise Optic 2000 – Lissac – Audio 2000 soutient notamment votre projet de CeRIAH mobile. Quelle est votre ambition à travers ces unités nomades de recherche ?
Pr P. A. : Le point de départ, ce sont les outils de diagnostic portatifs que nous développons au CeRIAH. Grâce à une petite équipe mobile, nous avons l’intention d’amener ces outils au plus près des patients concernés. Un médecin interniste, par exemple, peut suivre un patient atteint d’une maladie inflammatoire, chez qui il soupçonne une atteinte de l’audition. Nos outils nomades pourront alors l’aider à poser un diagnostic. Les données récoltées vont nous permettre de valider la fiabilité de nos outils, pour pouvoir les généraliser. Pour l’instant, nous nous déplaçons surtout en région parisienne. Mais nous souhaitons former des acteurs de l’audiologie, pour que nos nouveaux outils de diagnostic puissent être utilisés partout en France.
Vous vous intéressez également à la protection de l’audition normale ?
Pr P. A. : Oui, car comme dit le dicton, Mieux vaut prévenir que guérir. Dans cette optique, nous aidons l’association « La Semaine du Son » à construire un label de qualité sonore. Les sons compressés sont aujourd’hui beaucoup utilisés. Ils consistent à supprimer les écarts entre les sons forts et les sons faibles. Cela permet, par exemple, de mieux percevoir un morceau de musique dans un lieu bruyant comme la rue. Mais ces sons compressés -utilisés notamment dans les cinémas, lors des concerts, sur nos téléphones portables, à la télévision…- sont fatigants pour notre audition. Un label, affiché sur les produits utilisant des sons compressés, pourrait les classifier du vert au rouge. Un peu comme avec le Nutriscore, les consommateurs pourraient ainsi adapter leurs comportements et modes d’écoute. Libre à chacun ensuite d’utiliser cet outil comme il le souhaite.
Allez-vous utiliser l’intelligence artificielle dans certains de vos projets ?
Pr P. A. : Oui. L’un de nos objectifs est d’homogénéiser le très grand nombre de données de santé auditive aujourd’hui disponibles. Car chaque laboratoire a des pratiques et des outils différents. L’IA permet de fusionner toutes ces données. Cela nous permettra de comparer nos résultats à ceux des autres. L’IA va aussi nous permettre de traiter la multitude de données que nous récoltons à chaque fois que des volontaires viennent passer des tests. Et surtout, ces logiciels seront capables d’en extraire les données les plus pertinentes.
Pour en savoir : www.institut-audition.fr
