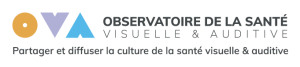
Les troubles des muscles oculaires

Strabisme, diplopie… Le système oculomoteur a ses propres pathologies, certaines très connues, d’autres plus confidentielles. Cheffe du service de neuro-ophtalmologie et oculomotricité à l’hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, à Paris, le Dr Catherine Vignal Clermont fait le point sur le sujet.
Combien avons-nous de muscles oculomoteurs, et surtout, à quoi servent-ils ?

Les muscles oculomoteurs (©Jase/Strabomania)
Dr Catherine Vignal Clermont : Il y a six muscles autour de l’œil : le droit latéral, le droit médial, le droit inférieur, le droit supérieur, l’oblique inférieur, et l’oblique supérieur. Les quatre muscles droits sont insérés en avant de l’équateur du globe oculaire, si l’on visualise l’œil comme une horloge, à 12h, 3h, 6h et 9h. Les muscles obliques, eux, sont insérés en arrière de l’équateur. A l’exception du petit oblique, ils sont tous attachés au tendon de Zinn, situé au fond de l’orbite. Tous ces muscles oculomoteurs arrivent « en bout de chaîne », de tout un circuit de commande qui prend naissance dans le cerveau et qui va permettre aux yeux de bouger dans l’orbite, et dans toutes les directions, en vertical vers le haut et le bas, en horizontal vers les tempes ou vers le nez, ou obliquement. Le muscle oblique supérieur, par exemple, permet de porter l’œil en bas et en dedans. Sans lui, nous ne pourrions ni lire, ni descendre les escaliers ! Les muscles sont très actifs, toujours en mouvement, même si nous ne le percevons pas toujours.
Quels sont leurs troubles les plus fréquents ?
Dr C. V. C. : Ils peuvent être rassemblés dans deux grandes familles : les atteintes paralytiques, et les non paralytiques.
- Le strabisme « classique » fait partie du groupe des atteintes non paralytiques. Il peut arriver précocement, ou plus tardivement. Il s’agit d’un mauvais alignement des yeux qui ne sont plus parallèles, un œil étant dévié par rapport à l’autre soit vers l’intérieur (le strabisme est dit convergent), soit vers l’extérieur (strabisme divergent), soit en vertical, mais les mouvements ne sont pas limités.
- Des paralysies peuvent aussi toucher ces muscles oculomoteurs. La paralysie peut être complète, ou partielle. Les yeux ne sont plus alors correctement alignés et le mouvement oculaire est limité dans le champ d’action du ou des muscles atteints. Le cerveau reçoit alors deux images au lieu d’une, et la personne atteinte va voir double lorsque les deux yeux sont ouverts. C’est ce qu’on appelle la diplopie binoculaire. Les strabismes paralytiques peuvent avoir plusieurs origines : une paralysie des muscles oculomoteurs, mais aussi une inflammation de ces muscles, nommée myosite.
- Les myokymies, elles, sont des contractions involontaires des paupières. La légende raconte qu’il pourrait s’agir d’un manque de magnésium, mais à ma connaissance, cela n’a jamais été prouvé par aucune étude. Quoi qu’il en soit, c’est tout à fait bénin. Ce trouble, à distinguer des nystagmus -mouvements incontrôlés des yeux- disparaît le plus souvent spontanément.
Les causes sont-elles connues ?
Les causes des désordres oculomoteurs sont multiples. Les strabismes de l’enfant, qui surviennent chez 2 à 5% de la population, traduisent un dérèglement de la vision binoculaire sans paralysie oculomotrice. Les atteintes paralytiques, elles, sont plus rares et souvent acquises. Elles demandent un bilan étiologique afin d’éliminer notamment une cause neurologique. En effet, elles peuvent être secondaires à une tumeur, une sclérose en plaques ou bien encore une cause vasculaire.
Comment le diagnostic est-il posé ?
L’ophtalmologue commence par mesurer l’acuité visuelle de son patient. Il vérifie ensuite la réfraction : y a-t-il une myopie ? Une hypermétropie ? Un astigmatisme ? Puis il regarde les mouvements oculomoteurs, d’abord œil par œil, puis les deux yeux en même temps. Il cherche à voir s’il y a une quelconque limitation. L’examen du fond d’œil est aussi important à effectuer. Le test de Lancaster est ensuite pratiqué. Il permet d’analyser les mouvements d’un œil par rapport à l’autre. Un éventuel trouble de l’alignement et de la motilité oculaire pourra ainsi être mis en évidence. Assis, le patient porte des lunettes, avec un verre rouge sur l’œil droit, et un vert sur l’œil gauche. Il regarde un tableau en face de lui, et doit pointer avec un laser le point lumineux montré par le spécialiste. Ces différents points permettent ensuite de détecter une éventuelle déviation oculaire.
« Le test de Lancaster est ensuite pratiqué. Il permet d’analyser les mouvements d’un œil par rapport à l’autre. »
Quels sont les traitements disponibles ?
En cas de strabisme précoce, il faut porter la correction optique totale prescrite après cycloplégie et, s’il existe une amblyopie, l’enfant pourra porter un cache par intermittence sur l’œil qui voit bien, pour forcer l’œil « paresseux » à travailler davantage et ainsi améliorer son acuité visuelle sur les muscles extraoculaires. L’objectif de cette opération, souvent planifiée avant l’entrée en CP, est de replacer correctement les muscles extraoculaires pour redresser l’œil dévié, mais ne permet pas de supprimer les lunettes et de rendre la vision binoculaire. Chez l’adulte, s’il existe un strabisme paralytique, il faut avant tout traiter la cause.
La diplopie ou vision double peut être supprimée initialement en cachant un œil. En cas de déviation modérée, la pose de prismes sur les lunettes peut aussi permettre de corriger cette vision double. Si cela ne suffit pas, il faudra alors opérer lorsque la déviation est stable et ne peut être prismée. Cette intervention sera réalisée en ambulatoire, sous anesthésie générale. Elle vise à remettre les deux yeux dans le même axe, mais ne supprime pas la paralysie.
