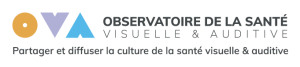
Quand la musique est bonne… pour le cerveau

Elle stimule la mémoire, joue avec nos émotions, aiguise nos facultés de concentration, développe notre langage… La musique « pianote » avec brio sur nos neurones. Neurologue, neurophysiologiste, auteur des « Pouvoirs de la musique sur le cerveau des enfants et des adultes » (éd. Odile Jacob), Pierre Lemarquis nous montre à quel point les sons sculptent et caressent notre cerveau.
Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous écoutons une chanson que nous apprécions ?
Pierre Lemarquis : Tout commence par une simple vibration. La musique, avant d’être une émotion ou un souvenir, est d’abord une onde mécanique, qui se propage dans l’air avant d’être captée par notre oreille externe. Cette onde fait vibrer le tympan, met en mouvement les osselets de l’oreille moyenne, puis atteint la cochlée, dans l’oreille interne. C’est là que tout s’accélère : les cellules ciliées transforment ces vibrations en signaux électriques, qui empruntent le nerf auditif jusqu’au cerveau. Premier arrêt : le cortex auditif, situé dans le lobe temporal. Très vite, le signal musical irradie vers d’autres régions cérébrales. L’hémisphère droit, souvent associé à la créativité, se montre plus sensible à la mélodie. L’hémisphère gauche, lui, est plus impliqué dans l’analyse rythmique. Plus étonnant, lorsque nous écoutons de la musique, des zones motrices du cerveau s’activent, y compris lorsque nous restons immobiles. Cette réponse motrice suggère l’implication des neurones miroirs. Face à un groupe de musiciens sur scène, ces neurones s’activent comme si nous étions nous-mêmes en train de chanter et de danser.
Le cerveau traite-t-il la musique comme le langage ?
P.L. : Les deux partagent de nombreux circuits neuronaux, notamment dans le cortex temporal et frontal. Les circuits de la musique sont plus nombreux et plus anciens que ceux du langage qui semblent s’être greffés dessus et en constituer une hyper spécialisation développée au cours de l’évolution : nos ancêtres ont chanté avant de parler. Le cerveau les traite d’une manière similaire, mais la musique va encore plus loin : elle active des zones supplémentaires, notamment liées à l’émotion et au mouvement. Des patients aphasiques -qui ont perdu l’usage de la parole- parviennent parfois à chanter des phrases qu’ils sont incapables de dire. La musique va les aider à sortir du silence. C’est le principe de la Thérapie Mélodique et Rythmée, précieuse alliée après un AVC, utilisée par les orthophonistes.
Quels sont les bienfaits de la musique chez les enfants ?
P.L. : Ils sont considérables. L’écoute attentive de musique stimule la concentration, la mémoire de travail (celle qui permet de garder temporairement une information à l’esprit) et l’intelligence émotionnelle. Jouer d’un instrument, même 30 minutes par jour, stimule les fonctions exécutives : attention, inhibition, flexibilité mentale, planification… Ces compétences sont cruciales pour la réussite scolaire et la gestion des émotions. La pratique musicale améliore également la conscience phonologique, facilitant ainsi l’apprentissage du langage et de la lecture. Des atouts précieux, dès le plus jeune âge.
Chez les adultes, la musique améliore-t-elle aussi la mémoire ?
P.L. : Oui, de manière significative. Elle renforce notamment la mémoire à court terme, en incitant le cerveau à anticiper les notes à venir. Ce mécanisme d’attente prédictive mobilise intensément le cortex préfrontal. Mais les effets ne s’arrêtent pas là. La musique réduit les niveaux de cortisol, l’hormone du stress, ce qui favorise une meilleure mémorisation et améliore les performances cognitives globales. Elle peut aussi aider à raviver des souvenirs enfouis, en particulier chez les personnes âgées ou atteintes de démence. Certains styles -comme la musique classique lente, ou les sons de la nature- ont également un pouvoir relaxant, utile pour apaiser l’anxiété ou améliorer le sommeil. D’autres genres, plus dynamiques, augmentent la vigilance et la motivation.
Le système du plaisir s’active-t-il vraiment à l’écoute de musique ?
P.L. : Absolument. Ecouter un morceau que l’on aime déclenche une véritable cascade neurochimique. De la dopamine, neurotransmetteur du plaisir et de la motivation, est libérée. La musique augmente aussi la production de sérotonine, qui réduit l’anxiété et améliore l’humeur, d’ocytocine, qui renforce le lien social et l’empathie, d’endorphines aux effets antalgiques et euphorisants, et même d’adrénaline, qui booste l’énergie. En somme, écouter de la musique, c’est provoquer une réaction chimique comparable à celle d’une drogue… sans aucun effet secondaire.
Des études suggèrent que la musique pourrait prévenir le déclin cognitif. Qu’en est-il ?
P.L. : Les recherches sont de plus en plus nombreuses à confirmer cette intuition. La musique ne guérit pas la maladie d’Alzheimer, mais elle peut en ralentir la progression. En sollicitant de nombreux réseaux neuronaux -sensoriels, moteurs, émotionnels…-, elle contribue à renforcer la réserve cognitive. Plus cette réserve est grande, plus le cerveau dispose de ressources pour compenser les effets de la dégénérescence.
Quelle est, selon vous, la plus grande découverte de ces dernières années sur les liens entre musique et cerveau ?
P.L. : Les chercheurs ont découvert que le cerveau considérait la musique comme une entité biologique. Concrètement, écouter un morceau de musique active les mêmes circuits cérébraux que ceux sollicités lors d’un échange avec un ami. La musique n’est plus vue comme un simple stimulus sonore, mais comme une forme de communication émotionnelle.
Qu’est-ce que la musicothérapie, et que peut-elle traiter ?
P.L. : C’est une pratique clinique encadrée, qui utilise la musique pour soigner. Elle peut prendre des formes très variées : écoute dirigée, improvisation instrumentale, chant, relaxation sonore… selon les besoins du patient. Ses bénéfices sont aujourd’hui bien documentés par la recherche. Elle se révèle efficace contre la dépression légère à modérée, les douleurs chroniques, les troubles de l’attention, ou encore les troubles du spectre autistique. Elle améliore aussi la qualité de vie des personnes atteintes de Parkinson ou de cancers, notamment en réduisant l’anxiété. A ce titre, elle mériterait d’être, un jour, prescrite comme un « médicament » à part entière.
Pour aller plus loin
La musique est une caresse pour notre cerveau, car l’écouter procure un déluge d’émotions positives. Mais comment le cerveau traite-t-il les sons ? Quels sont les liens entre l’audition et la mémoire ? Qu’est-ce que l’amusie congénitale ? Dans les six épisodes du podcast Les pouvoirs de la musique, Barbara Tillmann, directrice de recherche au CNRS, répond à ces questions, et à bien d’autres.
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-les-pouvoirs-de-la-musique
