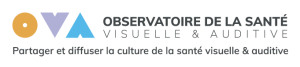
Sur les pistes de ski, les yeux et les oreilles sous haute protection

Les sports d’hiver sont des parenthèses enchantées dans un quotidien souvent surmené. Encore faut-il penser à protéger ses yeux et ses oreilles des potentiels dangers. Médecin des équipes de France de ski (FFS) et médecin du sport dans la région lyonnaise, le Dr Stéphane Bulle fait le point sur les risques. Et explique comment s’en protéger.
En altitude, l’intensité des rayons ultraviolets (UV) est bien plus forte qu’en ville. Non seulement elle augmente d’environ 10% tous les 1000 m d’altitude (à 3000 m, il y a donc 30% d’UV supplémentaires), mais en plus la neige, en raison de sa blancheur immaculée, réverbère jusqu’à 85% de ces UV. « Pour préserver ses yeux, il est donc essentiel de porter des lunettes adaptées à la luminosité », insiste le Dr Stéphane Bulle. Tous les masques de ski filtrent 100% des UV. Mais il est intéressant de les choisir le jour-même, comme on choisit sa tenue, en fonction de la météo. « En cas de brouillard, il est recommandé de porter un masque avec des verres jaunes. Pour filtrer 100% des UV, mais permettre en même temps de distinguer au mieux les reliefs. » La teinte jaune améliore en effet les contrastes. Le traitement anti-buée a son importance.
Au-delà du confort, c’est aussi une question de sécurité, une vision brouillée pouvant entraîner une chute. « Par beau temps, il faut des verres de catégorie 4, qui occulteront suffisamment la lumière, pour éviter l’éblouissement. » Les verres appartenant à cette catégorie sont foncés, ce qui les destine à des luminosités extrêmes, en haute altitude, ou sur un glacier. Des masques de ski peuvent être utilisés avec des « clips optiques » ou des lunettes de vue. Un conseil : les essayer avant de les acheter, afin de s’assurer de leur confort. Des opticiens, spécialisés dans le sport, peuvent vous accompagner dans le choix de votre équipement.
Uvéite, danger des pistes
Mal protéger son regard, c’est s’exposer à l’uvéite. « Cette brûlure oculaire est un coup de soleil dans l’œil. » Les médecins des stations de ski connaissent bien cette affection, très douloureuse. Celles et ceux qui en sont victimes ne se sont pas, ou pas assez, protégés. Les symptômes -douleur, rougeur et/ou impression d’avoir du sable dans l’œil- peuvent apparaître quelques minutes, et jusqu’à quelques heures après l’exposition. Heureusement, cette affection est réversible, et se soigne plutôt facilement. « D’abord avec, évidemment, l’arrêt immédiat de l’exposition au soleil. » Rester dans le noir, et retirer ses lentilles pour ne pas irriter davantage les yeux, peuvent soulager. « Une pommade à la vitamine A va ensuite permettre d’accélérer la cicatrisation. Des corticoïdes en gouttes pourront être nécessaires pour les cas les plus sévères. » À long terme, une exposition trop fréquente et non protégée aux rayons du soleil peut entraîner d’autres pathologies oculaires. Le cristallin, situé derrière la cornée et l’iris, absorbe en effet une grande partie des UV. Plus les yeux sont exposés au soleil, plus le cristallin vieillira rapidement, perdant sa transparence avec le temps : c’est la cataracte. Son opération est aujourd’hui la plus pratiquée en France. Au fond de l’œil, la rétine est elle aussi très sensible aux UV. Des expositions trop fréquentes peuvent, à terme, entraîner une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).
Traumatisme oculaire, rare mais (potentiellement) grave
« Les skieurs professionnels peuvent se prendre un piquet dans l’œil en course ou à l’entraînement. Chez les amateurs, les accidents sont plus rares. » Mais quand ils ne portent pas de masque, les conséquences peuvent être sérieuses. « À ski, on dépasse rapidement les 50 km/h. Quand vous tombez, vous êtes aussi peu protégé que si vous étiez à moto. » C’est une urgence. « Un traumatisme oculaire impose une consultation médicale immédiate, pour faire un bilan complet, voir s’il n’y a pas de plaie ou de décollement de la rétine, par exemple. » Pour le décollement de rétine, les symptômes peuvent mettre plusieurs jours à apparaître. C’est pourquoi, dans le doute, le médecin réalisera un fond d’œil, pour écarter cette piste.
À la montagne, ne pas négliger son audition
« Les amateurs qui commencent le biathlon ne pensent pas forcément à protéger leur audition. Or, la possibilité de souffrir d’un traumatisme auditif est bien réelle ! » Les détonations de l’arme peuvent en effet atteindre jusqu’à 160 dB. Les protections auditives sont absolument nécessaires. Mais si elles doivent atténuer efficacement le bruit des détonations, elles ne doivent pas compromettre la capacité à entendre les commandes nécessaires à la sécurité. L’idée n’est surtout pas de se mettre dans une bulle auditive, mais bien de se protéger des bruits les plus forts. « Les variations de pression pour l’oreille ne sont quant à elles généralement pas un problème lors de la pratique des sports d’hiver, car la montée en altitude se fait relativement doucement », rassure le Dr Bulle. La trompe d’Eustache, qui égalise la pression d’air de part et d’autre du tympan lors de la montée en altitude, a alors le temps de faire son travail. « Le risque augmente très légèrement si la personne a une otite ou une grosse rhinopharyngite. Ce risque, c’est celui d’une brèche tympanique. »
À la montagne, une discipline peut, elle, provoquer une otite traumatique, avec rupture du tympan : les chutes libres sur airbag. L’idée : sauter, d’une hauteur variable, sur un énorme coussin gonflable. « Il existe une possibilité de se prendre une « gifle » sur l’oreille. Pour se protéger, il faut penser à mettre un casque, couvrant les oreilles. » En cas de déchirure du tympan, le plus souvent, la cicatrisation se fait spontanément dans les semaines suivant l’accident. Quand ce n’est pas le cas, une greffe tympanique pourra être indiquée.
